- Titre original : Kids Stories
- Fiche mise à jour le 30/09/2014
- Année de production : 2011
- Réalisé par : Siegfried
- Date de sortie : 01 octobre 2014
- Date de reprise : non renseignée
- Distributeur France : non renseigné
- Distributeur international : Films Distribution
- Durée : 90 minutes
- Origine(s) : France
- Genre(s) : Expérimental
- Pellicule : couleur
- Format de projection : 1.66
- Format son : Dolby SR
- Visa d'exploitation : non renseigné
- Indice Bdfci :
3.5 | 3 |
Vos commentaires et critiques :
Kids stories se compose de deux segments d’inégale longueur qui ont pour centre un jeune garçon pour l’essentiel, même si le second contient une sous-intrigue mettant en scène une petite fille. L’unité du film n’en souffre pourtant pas ; c’est que Siegfried, cinéaste français dont c’est le quatrième long-métrage, adopte des parti-pris de réalisation identiques : caméra à l’épaule, jump cut, absence d’éclairage artificiel, prédominance des gros plans, panoramiques filés, image granuleuse et surexposée. L’une des gageures est de maintenir ces choix jusqu’au bout. Et, effectivement, pas une seconde n’y échappe, ce qui fait à la fois la force et la limite du film ; la fascination peut devenir agacement, à la suite du Rosetta des frères Dardenne, par exemple. Comme dans ce dernier, la caméra portée suit des déplacements à pied, souvent de dos. Mais l’unité vient aussi des multiples échos dont Siegfried parsème ses segments, aussi bien à l’intérieur de chacun que de l’un à l’autre : le recours à l’imaginaire enfantin (le robot d’un côté, la dame au faucon de l’autre), l’achat d’une glace, les reproches adressés aux enfants, le football, par exemple, se retrouvent à Calcutta et au Kazakhstan.
Le premier segment, le plus court et à notre sens le plus réussi, suit les pérégrinations de Kabir, qui fuit l’école où la professeure et le directeur se liguent contre lui, parce qu’il ne sait épeler ni « pomme » ni « ballon ». Il s’enfuit donc, croisant d’improbables figures dans des lieux divers : le cinéma, la fête foraine ou une agence de voyage. Tout le charme du film vient de ce regard à hauteur d’enfant porté sur le monde : les arbres en contre-plongée, un homme aux formidables moustaches et tant de détails que Siegfried traite à égalité. La déambulation, lointaine cousine d’un road movie cinématographique, se transforme en expérience de vie : Kabir connaît la peur, la compassion, voit l’amour incarné. Par les yeux surtout, mais aussi par le corps entier, il découvre l’infinie diversité d’un monde lumineux dans lequel la beauté alterne avec la misère la plus cruelle (un homme allongé agite son moignon). Son errance est également la concrétisation d’une révolte : à la discipline d’une école étouffante, il oppose un temps mort, non utilitaire, composé de plaisirs (nourriture, discussion, cinéma, manèges). Le début nous avait avertis : Kabir, en un geste frondeur, jette vers nous un avion en papier, avion qui d’ailleurs occupera une place importante vers la fin du segment. La révolte passe aussi par son uniforme dont il se débarrasse très vite, cet uniforme qu’on lui reprochait de négliger. Le garçon évoque alors la démarche rageuse d’Antoine Doinel dans Les 400 Coups de Truffaut, dont il partage le goût du cinéma. Siegfried choisit avec respect de regarder son héros évoluer : jamais de complaisance, pas d’effets attendrissants. C’est plutôt une vision naturaliste qui semble prélever des morceaux de réel, des séquences sans enjeu dramatique, avec le seul plaisir de capter des mimiques, une danse dans la rue, de grands yeux noirs dans l’obscurité. Tous ces détails qu’on ne peut saisir que dans le temps, dans l’observation têtue , mis bout à bout, forment un portrait attachant d’un enfant dont on ne sait presque rien, et que l’on quitte à regret sans qu’une fin (au sens de où un événement viendrait clore l’épisode) ne nous assène de morale. Au contraire, les multiples plans de mains, les nombreux échanges d’argent, inscrivent Kids stories dans un monde concret, quasi tactile.
Le deuxième segment, situé au Kazakhstan, s’ouvre au contraire du premier sur un grand espace. Les personnages se croisent et le regard posé sur cette civilisation qui nous semble exotique prend le temps de décrire des scènes de la vie quotidienne, sans que jamais une vision ethnologique ne s’impose. Très vite cependant, deux enfants se détachent dont nous suivons les quêtes minuscules : porter une lettre à sa grand-mère, avouer son amour à une fille. Comme dans l’épisode de Calcutta, la dramatisation est inexistante : ni l’égarement de la petite fille ni la réaction de l’aimée ne sont traités sous forme de suspens. Il s’agit moins de créer de la tension chez le spectateur que de lui donner à voir, dans toute sa longueur, la vie dans ses moindres détails. Et des détails, il y en a à foison : des poils de la grand-mère à la morve d’un bébé, rien de ce qui fait le quotidien dans sa trivialité n’est écarté. Pourtant une séquence magnifique dans sa simplicité même émerge : les doigts du garçon saisissent une longue mèche de cheveux de la fille dans un halo lumineux. Cet instant précieux, arraché à un univers commun, trouve la beauté comme par hasard, dans un frôlement étiré. Altimbek échappe ainsi à sa mère et ses reproches, à la promiscuité, aux responsabilités qui lui incombent, dans un moment de grâce. Là encore, on le voit, ce n’est pas l’intrigue qui compte. Même si elle trouve un dénouement plausible, au terme duquel le garçon marchera une dernière fois longuement, avant de s’asseoir, désemparé, l’histoire mince, presque transparente, évite les rebondissements et les lourdes explications. On parle peu dans le film, et c’est tant mieux : l’image suffit. Plus que la parole, c’est le regard qui rend ce monde oppressant : on a le sentiment que rien n’échappe aux autres ; en ce sens, le segment rend tous les personnages complices d’une surveillance perpétuelle, à laquelle même les héros participe, qui se fait voyeur pour épier sa belle.
On pourra reprocher au réalisateur des petites coquetteries, comme ces phrases musicales (dont il est le compositeur sous le nom de Sig) interrompues brutalement. On pourrait pinailler encore sur la dispersion du second segment. Mais Kids stories est un film qui fascine souvent et qui détonne dans la production courante. Le regard jamais condescendant qu’il porte sur l’enfance en fait un film rafraîchissant pour peu que l’on accepte de se laisser abîmer dans la contemplation sans attendre un scénario trépidant. C’est d’ailleurs le sens du noir au début : préparez vos yeux, nettoyez-les de toutes ces images convenues dont vous êtes abreuvés, quelque chose d’autre vous attend. Et le naturel des comédiens dont on imagine l’amateurisme concourt à cette réussite, même si les grands aînés, de Truffaut à Kiarostami pour les thèmes, de Cassavetes au Free Cinéma pour la réalisation, portent une ombre écrasante.
François Bonini

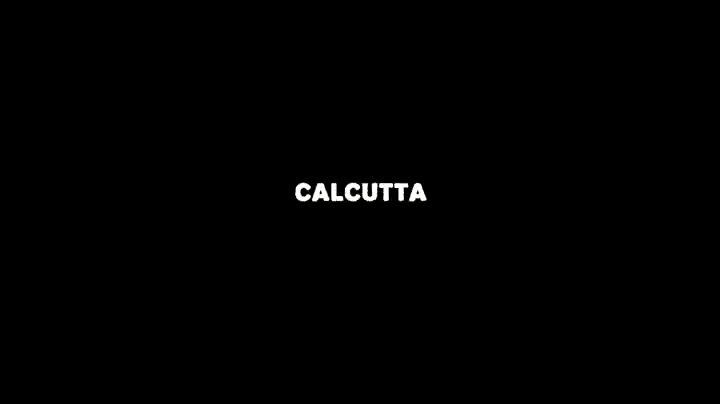 Copyright : © Droits réservés
Copyright : © Droits réservés